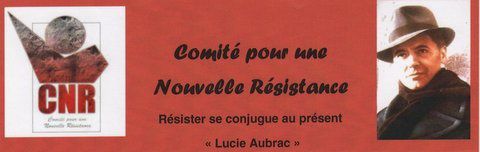Le développement qui suit a été motivé par le tout récent article, désespérant mais lucide de Mediapart, “ L’université : pourquoi ça n’intéresse personne ? ”.
Il nous aura fallu moins d’un an pour comprendre qu’Hollande et les Solfériniens poursuivent toujours le même objectif : satisfaire les rêves les plus fous de la droite et du patronat, soit de manière brutale comme quand ils prennent le parti de Mittal contre celui des travailleurs et des habitants des bassins sidérurgiques, soit de manière fuyante, comme avec les négociations sur les retraites qui finiront par donner satisfaction aux demandes du patronat, avec l’aide de la CFDT comme courroie de transmission.
 Les décisions des Solfériniens concernant l’université s’inscrivent dans le deuxième cas de figure. Non seulement la LRU n’a pas été abrogée d’un trait de plume (Hollande ne s’y était d’ailleurs pas engagé durant la campagne), mais aucune réflexion sérieuse n’a été impulsée par le pouvoir en place sur la nature de l’enseignement supérieur, son avenir, le rôle qui est le sien dans la société, la condition estudiantine, le statut des universitaires etc.
Les décisions des Solfériniens concernant l’université s’inscrivent dans le deuxième cas de figure. Non seulement la LRU n’a pas été abrogée d’un trait de plume (Hollande ne s’y était d’ailleurs pas engagé durant la campagne), mais aucune réflexion sérieuse n’a été impulsée par le pouvoir en place sur la nature de l’enseignement supérieur, son avenir, le rôle qui est le sien dans la société, la condition estudiantine, le statut des universitaires etc.
Pour beaucoup, l’université est l’énorme et pesante périphérie d’un petit centre prestigieux qu’il faut protéger et encourager sans réserves : les grandes écoles et les classes préparatoires. Une masse visible d’1,4 million d’étudiants, parfois remuants, masquent les élites de demain, quelques dizaines de milliers de jeunes issus pour la plupart de milieux privilégiés à qui l’État consacre 21 000 euros par an et par tête de pipe (trois fois moins pour les étudiants du tout venant). Ce sont donc les enfants et les parents les plus pauvres qui financent les études des enfants favorisés.
Cette situation me rappelle celle de la République de Côte d’Ivoire il y a trente ans. Dans l’université nationale, on rencontrait bien peu d’enfants de ministres ou d’actionnaires. Ils poursuivaient leurs études en France, mieux aux États-Unis. De même, les élites ne se faisaient pas soigner dans les CHU locaux mais dans les cliniques privées françaises (ou suisses) sur un coup d’avion.
Comme le souligne l’article de J. Confavreux et de L. delaporte dans Mediapart, « la gauche s’est accommodée d’un système à deux vitesses ». En conséquence, l’université n’est plus un enjeu politique puisque les Solfériniens ont tous intégré la nécessité de la philosophie du « processus de Bologne », dans lequel le Premier ministre Jospin avait pris toute sa part.
Rappelons que la LRU fut mise en œuvre par la fille d’un universitaire telle que la droite affairiste les affectionne : PDG de Bolloré Telecom (6 milliards de chiffre d’affaires par an). Enfant, puis jeune fille, Valérie Pécresse n’a eu aucun contact avec l’enseignement public : elle fréquenta l’Institution Sainte-Marie de Neuilly-sur-Seine, puis une classe préparatoire au lycée privé Sainte-Geneviève de Versailles, puis HEC, et finalement l’ENA où, enfin, elle rejoignit l’élite de la République. En 1997, après la dissolution de l’Assemblée nationale, elle fut approchée par Jospin (décidément, à un certain niveau tout se vaut et tous se valent) mais préféra Chirac. Elle sera un temps proche du pas très catholique Pierre Bédier, condamné en 2006 à 18 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux.
Vus son origine et son parcours, Pécresse était parfaitement à même de concrétiser la « déclaration de la Sorbonne », cosignée par Allègre en 1998, qui, par delà un habillage humaniste et progressiste (« L’Europe n’est pas seulement celle de l’euro et des banques »), voulait faciliter « l’employabilité » (concept cher à Blair) des étudiants.
La mise en œuvre du « processus de Bologne » impliquait dans les faits de soumettre l’université – de manière la plus réactive qui soit – aux nécessités de la compétition économique mondiale, d’intégrer les établissements dans le marché mondial de l’éducation et de la connaissance et de permettre aux investisseurs privés d’influer chaque jour davantage sur leur bonne marche.
La LRU (dont les auteurs se sont toujours contrefichés des étudiants comme d’une guigne) a profondément transformé le fonctionnement des universités (leur « bonne gouvernance », comme on dit désormais). Comme dans les pays anglo-saxons depuis longtemps, l’autonomie budgétaire concerne même la gestion des enseignants. Ce qui contribuera, à terme, à anéantir les statuts. Désormais, quantité d’enseignants sont recrutés pour un an, avec un service d’enseignement lourd leur interdisant la recherche.
J’avais vu il y a vingt ans des enseignants recrutés pour 3 ou 6 mois dans des universités hollandaises et je m’étais dit, naïvement, que cela ne pourrait jamais arriver en France du fait de l’existence même de la Fonction publique. Je m’étais lourdement trompé. L’autonomie implique également que les établissements deviennent propriétaires de leurs biens immobiliers. Des enseignants-chercheurs se sont donc transformés en agents immobiliers. Là encore, l’exemple vient de l’Ouest : quand j’étais moi-même étudiant, le syndicat des étudiants de l’université de Leeds était l’un des plus gros propriétaires fonciers de la ville. Pour rendre la « gouvernance » de l’université plus « moderne », la taille des conseils d’administration a été réduite, avec diminution du nombre des représentants des personnels et augmentation de celui des représentants de la société civile, id est des entreprises. Toujours dans un souci de modernité, le président de l’université, qui est désormais un véritable patron, dispose d’un droit de veto sur la nomination des professeurs.
Non seulement, ceux-ci ne sont plus nommés par des commissions de recrutement pérennes et élues démocratiquement, mais par des comités ad hoc à géométrie variable – ce qui renforce le mandarinat local. Et, en plus, ils peuvent être recalés par les présidents. Tout récemment, j’ai vu l’un de ceux-ci barrer pour une promotion un très bon candidat local, dévoué à son établissement depuis quinze ans, au motif qu’il n’avait pas candidaté ailleurs, donc qu’il ne s’était pas frotté à d’autres commissions de recrutement ! Quand un patron veut noyer son chien...
L’autonomie et la gestion de plus en plus capitalistique des universités institue également la défiscalisation des subventions privées. Les universitaires se prêtant à cette pratique contribuent à appauvrir l’État, qui les rétribue… Ajoutons pour finir que la modulation des services à l’échelle locale (le but à atteindre étant, en gros, un service « personnalisé » par enseignant) détruit les solidarités, avec des universitaires qui finissent par penser qu’ils n’exercent pas le même métier que leur collègue du bureau voisin. Tout cela s’accomplit avec le soutien enthousiaste d’une majorité des présidents d’université, nombre d’entre eux de gauche, certains élus sur des listes soutenues par le Snesup.
Les universitaires n’ont pas pensé à, n’ont pas su articuler leur lutte contre la LRU avec les luttes des personnels de justice massacrés par Daty et avec celles du monde hospitalier écrabouillés par Bachelot qui, désormais, encombre des plateaux de télévision pour des émissions à son niveau.
Lors de sa campagne électorale, Hollande n’a nullement remis en cause les fondements de la LRU et il a choisi en Geneviève Fioraso, son ministre de l’enseignement supérieur, une manière de Pécresse solférinienne. On peut compter sur Fioraso pour, après avoir balayé Proust de la culture française, encourager tous les partenariats publics-privés.
Dans son discours inaugural, Madame Fioraso enfila les lieux communs et les paroles verbales. Cette experte en langue de bois n’émit aucune critique de fond de la LRU, se contentant, ce qui ne mangeait pas de pain, de vouloir réenclencher le dialogue :
« Je suis très honorée de la tâche que m’a confiée Jean-Marc Ayrault à la tête du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Je mesure les enjeux de ce domaine décisif pour le développement et l’avenir de notre pays.
Je suis engagée depuis plusieurs années dans un travail collectif avec les acteurs du domaine, sur le pôle grenoblois comme au niveau national. Les orientations prises au Forum des Idées de l’Enseignement supérieur et de la recherche que j’ai présidé pour le PS en mai dernier se sont précisées pendant la campagne des présidentielles.
François Hollande a mis la jeunesse au cœur de son projet. La vie étudiante, la réussite en premier cycle et l’orientation seront donc des axes d’action prioritaires.
Depuis cinq ans, les universités, les organismes de recherche et tout leur personnel ont été bousculés par des changements insuffisamment concertés. Il est donc urgent de rétablir le dialogue en confiance. C’est le sens du discours fort prononcé par le Président de la République le jour de sa prise de fonctions, devant la statue de Jules Ferry, suivi d’un hommage à Marie Curie. Il a réaffirmé sa priorité pour l’école, l’Université, la recherche de la République et sa confiance dans un progrès partagé et durable en France et en Europe. »
Après un an de hollandisme, le climat universitaire est très attristant. Rien n’a bougé.
La lutte des classes s’amplifie sur les campus. Dans les grandes écoles, un étudiant sur deux est un enfant de cadre supérieur ou de profession libérale. Les étudiants des universités sont, comme tous les jeunes, en voie accélérée de prolétarisation. Pour beaucoup d’entre eux, l’université est un garage avant d’entrer dans la vie, non pas active, mais de chômeur. Un quart d’entre eux ne se soigne plus correctement. Un sur dix endure des conditions de logement misérables.

Les universitaires ploient sous les charges. Ils ont de moins en moins de temps à consacrer à l’avancement de leurs recherches. Ils font de l'administration (d’autant plus que le nombre de personnels IATOS ne cesse de baisser),
ils gèrent, ils se montrent sur internet, remplissent des logiciels de notes d’examen, rédigent d’innombrables dossiers grâce auxquels ils peuvent éventuellement obtenir des financements. Et ils vont chercher une machine à café à l’hypermarché du coin car la voiture de service est en panne.
Tout est fait pour les infantiliser, à commencer par l’état de fébrilité permanent dû à la nécessité d’anticiper les consignes qui viennent d’en haut pour ne pas prendre du retard par rapport à des mesures qui, bien souvent, feront l’objet de contre-ordre dans les semaines suivantes, où ne seront même pas prises. Dans un tel climat, comment prendre du recul, comment résister ? En plus du mandarinat local (de droite comme de gauche) dont ils souffrent au quotidien, les universitaires sont aliénés par une énorme machine administrative – aux plans local et national – qui abolit le sens, les repaires et qui fonctionne selon la logique entrepreneuriale privée.
Dans le cours du cursus doctoral lui-même, la pression exercée via les écoles doctorales afin d'imposer une réduction de la durée des thèses pour, prétendument, « faciliter comparaisons et équivalences au niveau international » (déclaration de la Sorbonne), fait craindre une dénaturation de la portée intellectuelle des diplômes et annonce la mort de la thèse « à la française », c’est-à-dire d’un travail de recherche personnel, long et approfondi. En d’autres termes, un œuvre de maturation. Dans le programme des concours de recrutement, le contenu disciplinaire disparaît progressivement. Dans peu de temps, un capésien d’anglais n’aura même plus à prouver qu’il connaît l’anglais.
L’universitaire d’aujourd’hui n’est pas requis de faire progresser la science mais plutôt d’apporter la preuve qu’il est un bon petit soldat du capitalisme financier. Sous Chirac et Sarkozy, la droite a imposé à l’université la notion de gouvernance. Un vocable dont l’acception contemporaine nous vient tout droit de la banque mondiale et qui fait partie de ces termes qu’on utilise « naturellement » sans les avoir définis au préalable. Le but réel de la gouvernance est l’éradication de la démocratie. On part – par exemple dans les pays du tiers-monde ou en Grèce – du fait que le cadre politique et institutionnel est défaillant (entre autres par manque de démocratie) pour agir en amont sur les modes de gouvernement. La gouvernance, qui est par définition « bonne » (good governance) propose des solutions toutes faites, garanties hautement techniques et, mieux encore, morales (lire à ce sujet Bernard Cassen)
Ce, en contournant les instances légitimes. Dans le monde de la recherche universitaire française, comme dans celui de la gestion des établissements, les initiatives ne viennent plus de la base mais d’instances nationales de plus en plus nombreuses, à l’existence et au fonctionnement opaques. Au mandarinat, au féodalisme d’avant 1968 (quand, par exemple, les doyens étaient nommés) ont succédé une surveillance panoptique autoritaire et un interventionnisme au coup par coup, sans autre perspective politique qu’une gestion au moindre frais et une observation attentive de l’évolution de l’ordre économique mondial.
Autre concept qui obsède les universitaires et qui n’a jamais été défini (et ne le sera jamais) : l’excellence. Il faut toujours plus d’excellence. D’où l’invention des « labex, des « idex », des « equipex ». Quand une institution forge ainsi des mots tronqués, ce n’est pas que pour le plaisir de l’euphonie. Cela cache un loup idéologique. La priorité dans l’université n’est plus de chercher, c’est d’être le meilleur, c'est-à-dire se présenter comme travailleur entrepreneur, doué d’une rhétorique personnelle mais sachant manier les concepts dans l’air du temps et capable de s’agréger à des réseaux visibles (qui n’a pas de réseau est mort).
Un entassement de publications, rédigées à plusieurs de préférence, sera apprécié, tout comme des liens de coopération internationale (pour que l’université ait un bon ranking à Shanghaï), des citations bibliographiques volumineuses, si possible « américaines » (je te cite, tu me cites et on se tient par la barbichette). Dans l’une des dernières commissions de recrutement à laquelle j’ai pris part, un collègue avait branché son ordinateur portable sur internet et comptait les points que valaient, selon un classement très arbitraire, les articles des candidats dont on lisait les dossiers. Ce total magique était pour lui le seul critère de recrutement, au détriment des qualités de pédagogue ou de l’investissement (gratis pro deo, rappelons-le) dans l’établissement d’origine. Ce n’est plus par son grade, attribué selon des procédures nationales, ni même par son renom qu’un chercheur est récompensé, mais par son image et sa valeur marchande. Et l’on ne saurait jouir d’une bonne image sans faire preuve de conformisme, de servilité, de carriérisme. Sans oublier une touche de singularité pour bien marquer sa différence, pour rappeler sans cesse que l’on existe.
Dans le domaine de la recherche, la précarisation est désormais le moyen de substituer des travailleurs dociles et sans perspective de carrière claire à des chercheurs statutaires maîtres de leurs recherches.
Sous la coupe de l’ANR, la recherche par projet est une des causes et des conséquences de la flexibilisation. L’horizon scientifique du chercheur précaire est limité, sujette à des demandes imprévisibles. Harcelé par ses supérieurs qui lui demandent régulièrement de s’atteler à des projets aussi incontournables que fatidiques (dont la préparation engage au moins autant d’énergie et de temps que la publication scientifique qui en résultera), il ne peut construire à long terme, surtout pas dans des disciplines non « rentables ». Le financement par projet favorise le surgissement de réseaux, d’agrégats ponctuels au détriment des centres de recherche pérennes et gouvernés selon des procédures démocratiques. Une institution aussi incertaine que l’université impose l’empirisme et la prudence dans le choix des thèmes de recherche et dans la manière de les traiter : ainsi il est dangereux de contester le cadre théorique à l’intérieur duquel on s’est engagé à travailler.
Avec Fioraso, les universitaires ont intérêt à fuir les petites ou moyennes universités. Dans ces établissements, la recherche est condamnée à moyen terme. Tout comme la préparation aux concours. Big is beautiful. Les grandes universités sont plus visibles que les petites. Et puis l’argent va à l’argent.
http://bernard-gensane.over-blog.com/universit%C3%A9-o%C3%B9-en-est-on