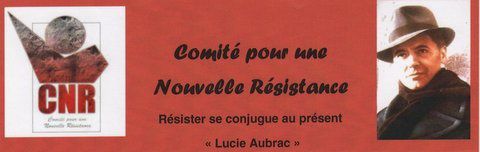Singulier unanimisme. L’ancien ministre des affaires étrangères Alain Juppé révélait, le 28 août dernier, « le vrai problème de l’économie française » : son manque de compétitivité (matinale de France Inter). Un mois auparavant, à l’annonce de huit mille licenciements par le groupe Peugeot (PSA), M. Jean-François Copé, secrétaire général de l’Union pour un mouvement populaire (UMP), avait déjà identifié une« priorité absolue », « la compétitivité de notre industrie », avant que le sénateur et ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin n’appelle de ses vœux un « choc de compétitivité », seul capable d’aiguillonner l’économie hexagonale.
L’accord parfait des ténors de l’UMP offrait un étonnant écho à celui des salons de Bercy et du palais de Matignon. Le premier ministre Jean-Marc Ayrault n’avait-il pas conclu la « conférence sociale » des 9 et 10 juillet avec les partenaires sociaux en fixant un objectif fondamental : « Améliorer la compétitivité de nos entreprises » ? Sur ce point, aucune cacophonie gouvernementale. Soucieux de justifier sa participation à l’université d’été du Mouvement des entreprises de France (Medef), le ministre socialiste de l’économie et des finances, M. Pierre Moscovici, précisait : « Nous serons là pour dire que le gouvernement est pleinement décidé à affronter le défi économique de la compétitivité, car ce n’est qu’en renforçant nos capacités de croissance que nous gagnerons la bataille de l’emploi (1). »
De la stratégie de Lisbonne, qui, en 2000, fixait un « nouvel objectif » à l’Union européenne — « devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » — aux « accords compétitivité-emploi », lancés par le président Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat, des injonctions à la « compétitivité fiscale » du patronat britannique aux plans de « compétitivité industrielle » de son homologue espagnol, le mot est sur toutes les lèvres. Il ne s’agit plus uniquement de gestion d’entreprise : dorénavant, les villes, les régions et plus encore les nations devraient également concentrer leurs énergies sur cet objectif prioritaire.
Pour s’en assurer, nos édiles et gouvernants sont invités à s’inspirer des théories du management développées dans les écoles de commerce américaines (2) : contrôle des coûts de production (« compétitivité-coût »), benchmarking (les pays sont comparés et classés comme des entreprises en milieu concurrentiel), marketing territorial (les territoires doivent « se vendre ») (3), recherche de financement (attraction des capitaux)… A mesure que se répand l’usage d’une telle boîte à outils, la compétitivité s’impose comme le nouvel étalon de la performance des territoires dans la mondialisation. Mais comment la mesure-t-on ?
Au sens le plus large, le terme désigne la capacité à affronter la concurrence avec succès. Appliquée à des territoires, cette notion mesurerait donc la réussite de leur insertion dans la géographie économique mondiale. Il suffit pourtant de consulter les ouvrages et articles — abondants — consacrés à cette question pour qu’apparaisse un premier paradoxe : en dépit de l’engouement qu’il suscite, ce concept s’avère particulièrement fragile sur le plan scientifique. Il transpose une notion micro-économique (la compétitivité des produits et des entreprises) dans la sphère politique (la compétitivité des territoires). Cette analogie est dénoncée par l’économiste Paul Krugman, lauréat en 2008 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel : « La compétitivité est un mot vide de sens lorsqu’il est appliqué aux économies nationales. L’obsession de la compétitivité est à la fois fausse et dangereuse (4). »
De nombreux spécialistes ont tenté de remédier à cette carence en faisant émerger une définition plus consensuelle, tel l’économiste autrichien Karl Aiginger, pour qui ce terme décrit de plus en plus une« aptitude à produire du bien-être » en milieu concurrentiel. Il indique que « le revenu et l’emploi sont générés à travers un processus dans lequel la rivalité et la performance relative jouent un rôle » (5). Cette conception suppose néanmoins que la concurrence généralisée entre territoires soit compatible avec l’amélioration du niveau de vie. Est-ce vraiment le cas ?
Et puis, une question demeure : peut-on vraiment suggérer que territoires et entreprises sont de même nature ? Un territoire, espace approprié et borné par une frontière, offre à un peuple son support physique ainsi qu’une bonne part de ses références culturelles et politiques. Il ne se réduit pas à des données, fussent-elles macroéconomiques. Les notes (rôle des agences de notation), les taux (inflation, intérêts, chômage...) ou les soldes (commercial, budgétaire...) ne reflètent qu’un aspect, superficiel et matériel, de la nation. Contrairement à une entreprise, celle-ci ne cherche pas à dégager de profits. Son action s’inscrit dans le temps long de l’histoire, pas dans l’immédiateté des marchés. Enfin, une nation ne dépose pas plus son bilan qu’on ne peut la liquider.
C’est pourtant sur cette assimilation que se construit la théorie de la compétitivité, un procédé qui puise aux sources de la mondialisation. Appliquée aux territoires, cette notion marque une nouvelle étape de la marchandisation du monde. Elle sous-entend qu’il existe un marché des territoires où les entreprises peuvent choisir leur localisation en faisant jouer la concurrence. Dans un monde où tout, ou presque, peut être coté en Bourse (droits à polluer, titres de dette, matières premières…), elle fait office de boussole pour les investisseurs : elle évalue la performance supposée d’un territoire.
Il n’en reste pas moins que l’exigence de compétitivité adressée à nos sociétés conduit légitimement à s’interroger. Quels sont les territoires compétitifs ? Selon quels critères ? Les classements (on parlera derankings) se sont multipliés ces dernières années (lire Géographie standardisée). Le plus célèbre, le rapport sur la compétitivité mondiale (« Global competitiveness report »), résulte des travaux des experts du Forum économique mondial (FEM). Ce document annuel, qui fait figure de référence, classe environ cent trente pays sur la base de notes qui oscillent entre 0 et 7. Or on n’y trouve rien de spécifique, ni dans ses méthodes (utilisation d’indices composites agrégeant de très nombreux critères (6)), ni dans ses conclusions.
Au fond, l’« industrie » des rapports sur la compétitivité dénoncée par Krugman se contente de recycler et de reconditionner des hiérarchisations économiques développées ailleurs : risque pays (travaux de la société d’assurance Coface), classements du produit intérieur brut (PIB) par habitant ou du climat des affaires (indice Doing Business de la Banque mondiale).
Toutes les nomenclatures relatives à la performance des nations présentent le même schéma : un centre compétitif formé par trois pôles (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique), auxquels s’ajoutent les pays arabes du Golfe. Cette percée des pétromonarchies demeure la principale originalité de ce type de classement. En Europe, l’Allemagne, les Pays-Bas et les Etats scandinaves délimitent un hypercentre aussi compétitif que les Etats-Unis, le Japon ou Singapour. Autour, la compétitivité se dégrade (différentes zones périphériques plus ou moins performantes) jusqu’aux marges extrêmes de ce système, avec certains pays d’Asie et la quasi-totalité de l’Afrique subsaharienne. Seule la position des deux grands émergents (Chine et Inde) diffère fortement en fonction des classements.
Cette vision hiérarchique révèle un autre paradoxe : ces classements n’ont que peu de valeur prédictive. La plupart du temps, les pays jugés compétitifs affichent les plus faibles taux de croissance, de forts déficits budgétaires et commerciaux, ainsi que des problèmes multiples (délocalisations, désindustrialisation). De fait, la croissance mondiale est actuellement portée en grande partie par des pays que le FEM considère comme périphériques. Jusqu’à la crise financière de 2007-2008, l’Irlande, l’Islande et Dubaï étaient présentés comme extrêmement compétitifs. Depuis, tous trois sont apparus très sensibles aux crises (spéculation démesurée, défaillance de la régulation financière, problèmes d’endettement).
De manière générale, les pays anglo-saxons faisaient office de modèles de développement. Or les événements récents ont disqualifié cette analyse : les parangons de la compétitivité se sont révélés des idoles fragiles. Ce manque de pertinence découle notamment des méthodes employées par des classements construits, pour l’essentiel, à partir de sondages réalisés auprès de cadres de grandes entreprises (7). Il s’agit d’une représentation, très marquée sociologiquement, et non d’une mesure à proprement parler de résultats obtenus.
Mais tenons-nous-en aux déclarations officielles : doper la compétitivité reviendrait à accroître l’emploi, la productivité et le niveau de vie. Selon les experts mandatés par la Commission européenne, « la concurrence est donc l’alliée, et non l’ennemie, du dialogue social (8) ». La mondialisation offrirait à l’Occident la possibilité de se débarrasser des activités manufacturières et des métiers à faible valeur ajoutée au profit d’emplois hautement qualifiés et mieux rémunérés. Une opération « gagnant-gagnant », en somme : d’un côté, les pays industrialisés bénéficieraient d’une spécialisation dans les services et le high-tech (« compétitivité hors prix », qui dépend de la capacité d’innovation et de l’exploitation de la propriété intellectuelle) ; de l’autre, le tiers-monde sortirait de la pauvreté grâce aux délocalisations, guidées par la « compétitivité prix » : l’abaissement du prix des produits par la baisse des coûts salariaux, la sous-évaluation de la monnaie et un crédit bon marché.
Ce tableau — que certains « pays-ateliers », dépeints comme de simples territoires low cost, ne jugeront peut-être pas très flatteur — a-t-il le moindre rapport avec la réalité ? Aucune économie, fût-elle hautement sophistiquée, ne peut s’émanciper des problématiques de coûts. L’Allemagne, si souvent citée en exemple, est un pays de très forte tradition industrielle. Elle a pourtant accru sa compétitivité par le biais de la stagnation salariale et d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dite « sociale » (une réduction des cotisations patronales compensée par l’augmentation des taxes sur la consommation des ménages). Ces mesures unilatérales coïncident avec l’envolée de ses excédents commerciaux. Par ailleurs, en dépit des mythes sur leur retard insurmontable, les pays émergents se révèlent de plus en plus performants dans des filières innovantes (informatique en Inde, énergies renouvelables en Chine…).
N’est-il donc pas illusoire de diviser le monde entre pays de la compétitivité hors prix (aussi appelée « structurelle ») et ceux de la compétitivité prix, condamnés à n’être que les petites mains de la mondialisation ? Qu’à cela ne tienne : le rapport Blanc de 2004, qui a inspiré la politique française des pôles de compétitivité, affirme que« pour retrouver un avantage comparatif, notre économie a le choix : s’aligner sur le modèle social asiatique ou faire la course en tête dans l’innovation (9) ». Sur la base de cette vision binaire, les dirigeants de la zone euro-atlantique entérinent les délocalisations des dernières décennies. Dans leurs discours, il est rarement question de rapatrier les millions d’emplois perdus dans le textile, la sidérurgie ou l’industrie du jouet. Les pays dont la production a basculé vers l’est seraient condamnés par la « fatalité économique » à réimporter ces produits et à se spécialiser dans les services et la recherche.
Mais cette stratégie de la compétitivité hors prix n’est-elle pas l’autre nom du renoncement politique ? Au-delà des fariboles du « gagnant-gagnant » et de la promesse d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi, il s’agit le plus souvent d’imposer des mesures impopulaires : augmentation de la TVA, modération salariale, austérité budgétaire… Ainsi, c’est au nom de la compétitivité que l’Union européenne et le Fonds monétaire international (FMI) ont exigé la réduction des salaires en Grèce (10). Moins performant que ses voisins, le pays devait baisser massivement la rémunération du travail, les plans de sauvetage garantissant provisoirement celle du capital, c’est-à-dire les intérêts perçus par le système financier. En ce sens, la compétitivité fournit une caution à ce qui s’apparente en réalité à un dumping généralisé.
Déjà, depuis les années 1980, on avait abandonné l’expression « dumping monétaire » (en théorie dénoncé par le FMI) pour lui préférer celle de « dévaluation compétitive », une opération qui consiste à maintenir le cours d’une monnaie artificiellement bas afin de favoriser les exportations nationales. Mais, le terme « dumping » conservant un caractère péjoratif, il semblerait qu’on l’ait désormais remplacé par celui de « compétitivité », suffisamment respectable pour autoriser un gouvernement à prendre des mesures antisociales sans craindre l’opprobre. En somme, ce mot permet de formuler de manière politiquement acceptable l’injonction à s’adapter à la concurrence, une stratégie que la population n’a pas nécessairement choisie et qui sous-tend la mondialisation néolibérale.
Promesse de prospérité débouchant sur des politiques de dumping : ce double discours paradoxal repose sur le dogme de la concurrence entre systèmes productifs. Si l’idée d’une « concurrence libre et parfaite » a guidé de multiples lois antitrust et antidumping (11), sa transposition à des territoires pose certains problèmes. Tout d’abord, il n’existe aucune autorité crédible de régulation de la concurrence entre nations. Ni l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ni le Bureau international du travail (BIT) ne semblent en mesure d’encadrer les différents dumpings. Ainsi, la Chine peut cumuler librement dumping social (bas salaires), environnemental (« havres de pollution » pour les industries), monétaire (sous-évaluation délibérée du yuan), réglementaire (laxisme des normes) et fiscal (faiblesse de l’Etat-providence et multiplication des zones exonérées de taxes). La loi du marché, appliquée aux territoires, s’avère fondamentalement faussée.
Le discours sur la compétitivité tente de masquer cet état de fait en corrigeant, à la marge, les disparités entre les sites de production. Ces efforts paraissent d’ailleurs dérisoires compte tenu des gigantesques différentiels de coûts : le blocage des salaires en Occident est-il réellement en mesure de rendre la rémunération des ouvriers français comparable à celle de leurs homologues vietnamiens ? A défaut de remplir cet objectif officiel (« gagner la bataille de la compétitivité »), ces politiques répondent aux attentes du patronat en matière de réduction du coût du travail.
Etonnant hasard, la quête de la compétitivité, assez peu concluante dans sa lutte contre les délocalisations, offrirait ainsi un alibi commode pour gonfler la rémunération du capital… En ce sens, l’invocation du « territoire » ou de la « nation » constituerait un artifice rhétorique, puisque le gain n’est pas collectif (notion d’intérêt général ou national), mais bien catégoriel (augmentation des profits de certains).
D’autre part, la mise en concurrence frontale des systèmes productifs entraîne forcément un effet dépressif sur les salaires, les revenus fiscaux et la protection sociale, eux aussi tenus de s’ajuster à la baisse. Ce phénomène ne pénalise pas uniquement les salariés (perte de pouvoir d’achat) et les Etats (baisse des recettes fiscales) ; il provoque aussi une atonie de la demande. Sans compter que, si tous les pays décidaient simultanément de contraindre leur demande, ils précipiteraient une grave dépression. De la même façon, tout le monde ne peut pas dégager des excédents commerciaux en même temps : il faut nécessairement des pays dans le rouge pour que d’autres soient dans le vert (12). L’obsession d’une « convergence des compétitivités » sur le modèle allemand n’est donc qu’une fable.
Dès lors que l’on constate la fragilité théorique du discours sur la compétitivité — puisqu’il conduit à des diagnostics erronés et à un dumping dissimulé —, comment expliquer son succès auprès des dirigeants politiques ? Peut-être par le fait qu’il répond aux injonctions des entreprises et des marchés internationaux. Or, s’étant privés des moyens de contrôler les unes et les autres, les élus s’adaptent désormais à leurs exigences. En définitive, l’objectif de la compétitivité masquerait une perte d’autorité et de souveraineté des Etats-nations. Il permettrait d’évincer, dans l’action politique, toute possibilité de protection. Alors que le territoire, avec ses frontières et ses institutions politiques, apparaissait traditionnellement comme un rempart face aux menaces extérieures (qu’elles soient militaires ou commerciales), cette fonction protectrice s’estomperait désormais avec l’affaiblissement des barrières douanières et des prérogatives de l’Etat.