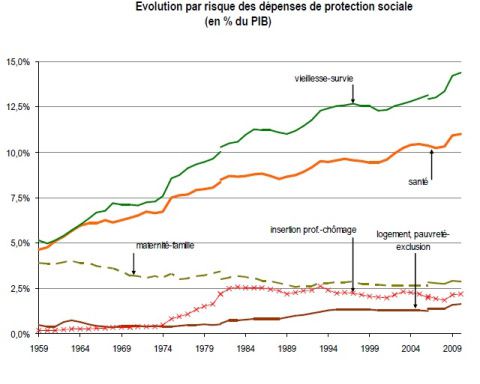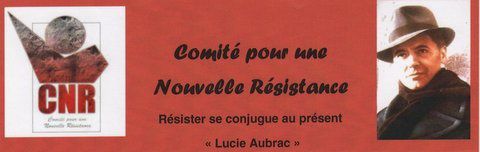Il était question d’historiens à l’instant, gageons qu’un de leurs motifs d’ébahissement tiendra à l’extravagante indulgence dont le groupe social de la finance aura pu jouir relativement à l’ampleur de son pouvoir de destruction avéré. Car cinq ans après le désastre : rien ! — et la « loi de séparation et de régulation bancaire » est à peine mieux que rien. L’idée de départ était pourtant simple : les marchés sont intrinsèquement instables, les activités de marché sont donc intrinsèquement déstabilisantes. Pas seulement pour elles-mêmes mais pour l’économie tout entière quand l’accident franchit des seuils critiques. Par conséquent, de deux choses l’une : ou bien l’on en prend son parti et l’on s’habitue par avance à devoir régulièrement repasser par des épisodes semblables, avec récession et mobilisation du corps social tout entier pour sauver la finance ; ou bien on choisit d’y mettre un terme, c’est-à-dire de cantonner la nuisance au cordon sanitaire. Dans un mélange de candeur et de parfaite sûreté de soi, Frédéric Oudéa, le patron de la Société générale, en effet « pas gêné » (au sens de Karine Berger), a cependant fini par lâcher le morceau en avouant que la loi de « séparation » n’allait le séparer que de 1,5 % du total de ses activités…
Pour avoir, donc, quelque chose qui ne soit pas rien, il aurait fallu au texte de loi, en dépit de toutes ses dénégations, ne pas se laisser complètement intoxiquer par les jérémiades de l’industrie financière qui jure que chacune de ses opérations, même des plus scabreuses, est une « contribution au financement de l’économie ». Mais les esprits socialistes ont été dévastés par l’idée que le financement par le marché est d’une incontestable modernité — « et donc » toutes les activités connexes qui vont avec : couverture, fourniture de liquidité, financement du shadow banking systemetc. Reste 1,5 %.
« Quand certaines entreprises comme Vinci, ont besoin, pour financer des projets à dix ou quinze ans, de plusieurs centaines de millions d’euros, elles se tournent non pas vers des banques commerciales mais vers des banques d’affaire, qui pratiquent là des activités de marché non pas spéculatives mais utiles à l’économie concrète », proteste Karine Berger pour rejeter un amendement qui demandait plus que la simple filialisation des activités de marché. Mais rien n’établit que le coût total du financement obligataire soit beaucoup plus compétitif que celui d’un crédit bancaire classique. En revanche, on sait avec quelle brutalité une entreprise en difficulté peut se voir refuser tout accès aux marchés — ironie du sort, elle n’a plus alors qu’à trouver une banque secourable qui acceptera de lui sauver la mise avec du bon vieux crédit à la papa. Les banquiers français glapissent que, empêchés de conduire ces opérations de marché, ils perdraient clients, chiffre d’affaire et profit. S’agissant de leur chiffre d’affaire, de leur place dans la hiérarchie mondiale des plus grandes banques, et de leur profit, la collectivité doit d’emblée affirmer clairement qu’elle s’en fout ! Le corps social n’a aucun intérêt à jouer au jeu infantile de la plus grosse qui passionne les capitalistes (plus encore les financiers), il aurait même l’intérêt exactement contraire. Il s’en aperçoit désagréablement au moment de ramasser les morceaux en prenant conscience qu’un secteur bancaire qui pèse (en actif total) jusqu’à quatre fois le produit intérieur brut (PIB), comme c’est le cas en France, lui laisse entrevoir l’ampleur possible de la facture — et que la « grosse » lui laisse le fondement un peu douloureux.
Que les banques ne soient pas trop grandes, mais ternes et sans attrait, qu’elles fassent des profits modestes qui ne leur donnent pas le délire des grandeurs et n’engraissent pas les actionnaires (ou les traders), c’est exactement l’objectif à poursuivre. Quant à leurs grands clients, ces derniers comprendront assez vite que, supposé un coût supérieur du crédit bancaire (par rapport au financement de marché), celui-ci paiera bien la continuité d’une relation partenariale qui ne les abandonnera pas au premier tournant — là où les marchés les éjecteraient à la moindre difficulté sérieuse. Il y a donc peu de chance pour que Vinci ne confie plus ses destinées qu’à Goldman Sachs.
Mais la manie des marchés qui habite les socialistes français va maintenant jusqu’à souhaiter d’y plonger les petites et moyennes entreprises (PME). On sait assez que les relations de ces dernières avec les banques ne sont pas une allée semée de pétales de rose… Mais l’idée de les rendre modernes en les envoyant se faire voir au marché est une trouvaille où l’ineptie le dispute à l’entêtement idéologique. Car de deux choses l’une : ou bien seule la crème des PME y aura accès et alors, par construction, la chose demeurera marginale ; ou bien l’on y envoie gaiement le gros de la troupe, soit des milliers d’entreprises, et l’on se demande bien comment les analystes financiers ou les agences de notation pourront avoir quelques suivis sérieux d’un nombre aussi élevé de débiteurs, là où les réseaux d’agences bancaires, au contraire, ont une connaissance locale et fine de leurs clients — attendons-nous donc aux ratings à la louche façon subprime.
Bien sûr l’élite bancaire ne se reconnaît pas entièrement dans la métaphore charcutière, mais c’est quand même un peu l’idée. Ou plutôt le sophisme : si la forme supérieure du financement de l’économie est à trouver dans le marché, alors tout ce qui contribue à la belle activité du marché est peu ou prou désirable. Sous une forme un peu plus sophistiquée, l’argument se décline le plus souvent sous la thèse increvable de la liquidité : pour que des agents de l’économie réelle émettent avec succès des titres sur les marchés, il faut qu’ils trouvent preneurs, et pour que les preneurs acceptent de souscrire, il faut qu’ils soient certains de ne pas rester « collés » et de pouvoir sortir à tout instant du marché. Il importe alors que le segment de marché considéré connaisse une activité permanente suffisante pour que chaque vendeur soit assuré de trouver acheteur (et réciproquement). La liquidité, voilà donc la justification ultime de la spéculation qui en finirait presque par se présenter comme un service public : foin des appâts du profit — du tout, du tout — les spéculateurs, certes en première instance, étrangers à l’économie réelle, n’en sont pas moins ses fidèles desservants puisqu’ils s’offrent à être contreparties pour tous les autres agents qui ont besoin d’entrer ou sortir du marché, assurant finalement qu’il tourne bien rond, donc permettant qu’il finance efficacement… les agents de l’économie réelle, quod est demonstrandum.
Dire « spéculateur » est par conséquent inutilement blessant : préférer « teneur de marché ». Certes la « tenue de marché » révèle de fortes accointances avec la recette du pâté d’alouette car — étonnamment — on observe en général dix fois plus d’opérations spéculatives que d’opérations à finalité « réelle » — pour sûr le marché est bien tenu… La plus charitable des interprétations conclurait que le « service public de la liquidité » est fâcheusement entropique — et en fait, pur prétexte à la pollution spéculative. La liquidité serait aussi bien assurée avec… neuf fois moins d’opérations de « teneur de marché », et encore par beau temps seulement. Car, en cas de coup de tabac, les « teneurs », pas fous, font comme tout le monde : ils fuient le marché à tire-d’aile, laissant la liquidité s’effondrer, au moment où on en aurait le plus besoin.
Ce sont pourtant ces opérations de teneur de marché que la loi de « séparation » tient beaucoup à ne pas séparer — à l’inverse de la Commission européenne (rapport Liikanen), qui cède visiblement à tous les vents mauvais du populisme. Evidemment n’importe quelle opération spéculative pour compte propre peut, sur simple demande, être requalifiée de « tenue de marché » — c’est bien pratique. En résumé, tout et n’importe quoi sur les marchés est tenue de marché : toute offre puisqu’elle permet à un acheteur d’acheter, et toute demande puisqu’elle permet à un vendeur de vendre… Il suffisait d’y penser ! Puisque n’importe quoi contribue à tenir le marché et que le marché est ce-qu’il-nous-faut-pour-financer-l’économie, il faudrait être idiot, inconscient ou de mauvaise foi pour séparer quoi que ce soit — puisque tout sert. La commission des finances française s’est rendue sans hésitation à cet argument de simple bon sens — moyennant quoi, en effet, 1,5 % et Oudéa pas gêné.
C’est une direction tout à fait semblable, et en fait identiquement argumentée, que prend le texte de loi en matière de relation des banques avec les hedge funds. Fléaux avérés, les hedge funds, dont c’est constitutivement le principe que de prendre des positions risquées et très leviérisées, devraient être isolés dans l’équivalent financier de léproseries, et en tous cas interdits de toute relation avec le système bancaire — après tout, que les héros du marché se débrouillent pour trouver leur financement sur les marchés. Mais, se dit le ministre Moscovici, les hedge funds sont des éléments de ce shadow banking system, dont nous savons qu’il détient maintenant quelques 20 % du total des actifs financiers — interprétés, toujours par le même contresens, comme « 20 % des contributions au financement de l’économie » —, c’est donc très important — parce-que très utile à l’économie. La conclusion s’ensuit, comme déroulé de papier à musique : il ne faut surtout pas empêcher les banques de financer leshedge funds qui financent l’économie. Bravo ministre ! Une objection élémentaire lui signalerait pourtant que les banques pourraient financerdirectement l’économie au lieu de passer par la case hedge funds… qui en fait Dieu sait quoi. L’objection pourrait d’ailleurs être généralisée à tout leshadow banking system, ce trou noir agglomérant les entités financières les plus obscures et les moins régulées, et qui a pris cette importance uniquement parce que le crédit bancaire s’est laissé évincer au nom de la modernité. Que les banques universelles cessent de financer par crédit ce système de l’ombre, et ce serait simultanément le meilleur moyen d’en piloter l’attrition relative, et pour elles-mêmes de se protéger de la vérole que ce système ne cesse de répandre — rappelons que la catastrophe Bear Stearns commence avec la fermeture de ses deux hedges funds les plus « sophistiqués », que BNP-Paribas avait dû fermer inopinément trois des siens à l’été 2007, et que la grosse catastrophe tourne vraiment au vilain avec la fermeture des money market funds à l’automne 2008. Personne ne pourra soutenir qu’un financement sain des entreprises et des ménages ne pourrait être pris en charge par le simple crédit bancaire et ne pourrait être assuré que par ces entités.
Mais non ! Les banques universelles pourront continuer de prêter auxhedge funds et d’exposer à leur risque les dépôts du public. « Nous avons pris toutes les précautions », se défendent les promoteurs du texte, voyez seulement l’alinéa 10 de l’article premier : les banques ne pourront avoir d’exposition non sécurisée vis-à-vis des fonds à effet de levier. Et puisque ne seront autorisées que les transactions « sécurisées », n’est-ce pas que la sécurité règnera ? Mais en quoi ces sécurisations consistent-elles au juste ? En cette pratique extrêmement commune de la finance spéculative dite de la « collatéralisation » : une entité emprunte auprès d’une autre en déposant en gage un actif d’une valeur équivalente à celle du prêt contracté. Or rien n’est sûr dans cette affaire ! On notera pour commencer que toutes les opérations de prêt à des hedge funds sont déjàcollatéralisées (« sécurisées » au sens Moscovici-Berger) — c’est simplement l’actuelle pratique ordinaire en cette matière ! Et l’on comprendra alors que le texte de loi ne produit rigoureusement aucun changement, donc aucune restriction sous ce rapport.
Mais surtout les actifs apportés en collatéral peuvent voir leur valeur s’effondrer, précisément à l’occasion d’une crise — les collatéraux sont supposément des papiers de « très bonne qualité », mais l’épisode de 2007-2008 a suffisamment montré que le réputé triple-A parfois ne valait pas tripette... Le débiteur est alors prié de compenser par de nouveaux apports, mais en une conjoncture de crise où très probablement ses positions sont en train de se détériorer à grande vitesse, et où sa liquidité se trouve mise sous haute tension. En d’autres termes, le fonds débiteur doit se procurer un supplément d’actif collatéralisant, et pour ce faire, d’abord de la liquidité, au moment précis où celle-ci lui manque le plus — parfois au point de voir tous ses accès aux financements de marché brutalement interrompus. Comme on sait, ce sont ces tensions ingérables sur la liquidité qui ont électrocuté tout le système financier par les circuits de la collatéralisation (et des appels de marge) en 2007-2008.
Du côté des créanciers qui reçoivent ces collatéraux, les choses ne sont pas plus sûres. Compte non tenu des problèmes soulevés à l’instant, les opérations de collatéralisation ne rempliraient vraiment leur office de back-up que si les collatéraux étaient rigoureusement conservés dans des comptes sanctuarisés. Mais qui peut croire qu’une banque pourrait ainsi mettre soigneusement de côté, en s’abstenant d’y toucher, les actifs qu’elle reçoit en collatéralisation de ses crédits ? Lorsque ceux-ci sont de bonne qualité (ou supposés tels), ils constituent une ressource financière qu’aucune banque ne consent à laisser oisive. Aussi la banque va-t-elle se défaire sans tarder du collatéral qui normalement la couvre, soit pour à son tour collatéraliser une de ses propres opérations quand elle se trouve du côté débiteur, soit pour retourner au cash en le vendant dans le marché. Il est désormais toute une partie des marchés monétaires, dite « Repo » (pour Repurchasing), qui procure de la liquidité à court terme contre collatéraux — et où ceux-ci circulent hardiment. Et lorsque vient le coup de grisou, i. e. le défaut d’un débiteur, par exemple d’un hedge fund, où est le collatéral ? Parti depuis belle lurette pour servir à prendre d’autres positions, dont certaines seront très probablement devenues perdantes en temps de crise — évidemment, tout comme la liquidité, la collatéralisation fait partie de ces « sûretés » qui fonctionnent très bien… quand elles n’ont à protéger de rien.
Comme souvent en matière de finance, le diable est dans les détails, ou plutôt dans d’obscurs recoins techniques, à l’image, par exemple, de la question des exigences de marges dans les transactions sur dérivés — dont on jugera a contrario du caractère stratégique à la manière dont les velléités du Dodd-Frank Act en cette matière ont été soigneusement annihilées par le lobbying bancaire nord-américain. La « gestion des collatéraux » en fait tout autant partie. C’est en effet par ce genre de canaux que se propagent les spasmes de la finance. Au lieu de se gargariser avec l’illusion des « transactions sécurisées », le législateur socialiste s’il avait deux sous de volonté régulatrice, réformerait drastiquement les dispositions relatives au traitement des collatéraux — ou plutôt en instituerait, puisque en ce domaine, les opérateurs financiers font exactement ce qu’ils veulent. On mesurera d’ailleurs l’inanité du socialisme de gouvernement à ce fait qu’il réussit même à être en retard sur l’autorégulation de la finance ! Car les banques elles-mêmes, pour le coup conscientes de ce qui a failli les tuer, commencent à se préoccuper sérieusement de modifier leurs pratiques en matière de collateral management [5] — jusqu’au point d’envisager de réserver les collatéraux pour leur faire jouer pleinement leur rôle de sécurité.
Malheureusement, l’autorégulation bancaire est affligée d’une lamentable inconstance. Sous le coup d’une peur bleue, les banquiers jurent qu’ils ont retenu la leçon et qu’on ne les y prendra plus… L’expérience montre pourtant que leurs bonnes résolutions s’évanouissent avec le temps qui les éloigne du traumatisme, pour être complètement oubliées quand revient l’euphorie de la bulle d’après. Ce que le législateur socialiste n’a visiblement pas bien compris, c’est la force de la loi, ou du règlement, seuls à même de tenir des autorégulés dont la « constance » est entièrement gouvernée par leurs affects du moment. Parmi toutes les œuvres utiles que ce texte de loi aurait pu accomplir, il y avait donc l’institution d’une stricte obligation de mise sous séquestre des actifs reçus en collatéral — et déjà l’on aurait entendu Frédéric Oudéa commencer à couiner. Proposition tout à fait générale et qui n’excluait en fait nullement d’interdire purement et simplement toute transaction des banques avec les hedge funds et leshadow banking system — après tout, on verra bien comment ces jolis messieurs se débrouillent privés de crédit bancaire.
Non seulement la matière séparée, à force d’exemptions et de validation des pratiques ordinaires, est-elle tendanciellement inexistante (1,5 %), mais la forme même de la séparation a tout du concubinage prolongé. De ce point de vue, la « Volcker Rule », les rapports Vickers et Liikanen, ainsi que le projet Moscovici ont au moins en commun le même entêtement dans le contresens, et la même illusion de la « capitalisation séparée », alias : on range les activités « à problème » dans une filiale soumise à des ratios de capital (Tier-1) « plus exigeants », et nous voila parés contre tout inconvénient.
C’est n’avoir toujours pas compris que les ratios de solvabilité sont parfaitement secondaires dans ces processus de crise financière qui n’explosent que par le retournement brutal des jugements sur une classe d’actifs et la constriction foudroyante qui s’ensuit de la liquidité du segment de marché correspondant, puis de tous les segments latéraux, atteints de proche en proche par les effets de report de la ruée vers le cash [6]. On rappellera donc pour la énième fois que Bear Stearns et Lehman Brothers se sont effondrés avec des Tier-1 très au-dessus des minima réglementaires les plus exigeants. Après cinq années laissées à la méditation soigneuse des mécanismes et des conséquences de la crise financière, on est un peu consternés que les apprentis régulateurs n’aient toujours pas saisi que les plus belles capitalisations séparées ne protègeront jamais une banque de marché du désastre.
En réalité, la seule mesure faisant quelque peu sens en cette matière est celle proposée par Goodhart et Persaud de rendre les ratios de solvabilité contracycliques [7] : plutôt que d’être fixées une fois pour toutes, les exigences de fonds propres croîtraient proportionnellement aux prix de marché d’une certaine classe d’actif suspecte d’être en proie à une bulle, et des encours de crédit qui s’y déversent. Encore faut-il ne pas se méprendre sur l’effet véritable de cette mesure, qui a moins, comme on le répète à satiété, pour propriété principale d’épaissir le « coussin de capital permettant d’absorber les pertes », que de resserrer progressivement la capacité des banques à accorder des crédits dans le segment de marché considéré, donc de ralentir le développement de la bulle. En d’autres termes, les ratios de capital contracycliques ne participent pas tant, comme on le croit le plus souvent, d’une politique prudentielle que d’une politique monétaire (mais poursuivie par d’autres moyens), puisqu’il s’agit moins de renforcer la base de capital des banques que de réguler leur offre de crédit.
Les contresens de principe n’excluant pas ceux d’exécution, le recours à la filialisation, par opposition au bank split en bonne et due forme, vient porter la complaisance régulatrice à son comble. Karine Berger s’exclame en commission des finances qu’en cas de pépin, la filialisation laisserait intacte à coup sûr la maison-mère — dépositaire des encaisses monétaires de la clientèle des particuliers. Car le texte de loi stipule que la filiale de marché doit être traitée par sa holding comme une entité extérieure, en conséquence de quoi lui sera appliquée la directive « grands risques » qui interdit à une banque de concentrer plus de 10 % de ses fonds propres dans des engagements risqués sur une seule entité. La banque holding ne pourrait donc se livrer à un éventuel renflouement de sa filiale au-delà de cette limite, en foi de quoi Karine Berger croit pouvoir conclure qu’« à [son]sens c’est la garantie d’une étanchéité absolue en cas de faillite d’une filiale vis-à-vis de la maison-mère » [8]. Il est cependant possible que « son sens » ne soit pas celui auquel il faille se confier aveuglément, et pour de nombreuses raisons.
En premier lieu, l’« étanchéité absolue » est tout de même autorisée à laisser passer 10 % des fonds propres… En second lieu, le règlement n°93-05 de la Banque de France, relatif au contrôle des « grands risques » [9], indique que le volume de risques sur une seule entité s’entend comme « risques nets pondérés », ce qui signifie que le volume brut de crédit de secours apporté par la holding à la filiale pourrait aller bien au-delà du seuil des 10 % de fonds propres. C’est bien ce volume brut qui importe en situation de crise, où comptent avant tout les ressources mobilisables pour faire face à une crise majeure de liquidité. On peut donc gager que la holding fournirait tout ce qu’elle peut à sa filiale pour la sauver, jusqu’au point où ses engagements bruts sur cette dernière excèderaient significativement 10 % de ses fonds propres — 10 % tout ronds, pour BNP-Paribas, ça fait tout de même déjà 7,5 milliards d’euros, une paille si la filiale venait en bout de course à faire défaut pour de bon. Mais comme toujours dans cette affaire, le danger n’est pas tant de manger les fonds propres que de se trouver face à des besoins urgents de liquidité impossibles à satisfaire. Or, précisément, en situation de crise, la liquidité est LE problème, et pour tout le monde. Qui peut imaginer que le spectacle d’une holding contrainte d’apporter dans la précipitation des concours à sa filiale, donc qui exprimerait des besoins de liquidité massifs, laisserait les opérateurs de marché indifférents, et qu’en serait-il alors de la possibilité effective pour cette holding de les financer ?
C’est en général à ce moment que la question de la solvabilité, objectivement secondaire, n’en fait pas moins retour, mais sous la forme vicieuse d’un accélérateur de panique. Car, pour tous leurs défauts de pertinence, les ratios de solvabilité n’en sont pas moins scrutés par les opérateurs des marchés de gros du crédit [10], où ils sont interprétés comme un signal sur la qualité des débiteurs… même pour la fourniture de liquidités de court terme [11]. C’est tout le charme de la finance de marchés que la croyance y fait loi : il suffit donc que le jugement des opérateurs se cristallise sur un indicateur quelconque pour que celui-ci acquière une importance, et un pouvoir d’entraîner des effets, qu’il ne possède nullement par lui-même. Si les opérateurs se mettent — et c’est le cas en situation de crise ! — à considérer que les débiteurs doivent être jugés d’après leurs ratios Tier-1 et que seuls les meilleurs auront accès à la liquidité, malheur à celui qui vacillera en cette matière : ses sources de financement se fermeront les unes après les autres, jusqu’à l’apoplexie finale… semblant donner raison à la « théorie » qui se sera en effet révélée « vraie »… mais pas du tout pour les raisons qu’elle croit. En tout cas voilà aussi ce qui pendra au nez de la holding encombrée d’une filiale de marché en train de prendre l’eau : car la holding devra consolider les pertes de cette dernière… et voir ses propres ratios de solvabilité prendre sérieusement de la gîte. Avec menace subséquente sur sa propre capacité à maintenir la continuité de ses financements… au moment où ils devraient être le mieux garantis pour venir au secours de la filiale en perdition.
A part ça, Karine Berger voit dans la (fausse) séparation par filialisation« une garantie d’étanchéité avec la maison-mère ». « A [son] sens ». Mais tout est faux, « au sens » de n’importe quel autre regard tant soit peu décidé à tirer les conséquences de ce qui s’est passé, dans les invraisemblables préventions dont ce texte de loi fait preuve à l’égard de ce qu’on présenterait sans exagération comme le plus grand pouvoir de destruction sociale — mais celui-ci est en costume trois pièces, en vertu de quoi il passe rigoureusement inaperçu… en tous cas aux yeux de ses semblables. Pour qui pourtant veut bien se donner la peine de simplement s’y pencher, l’histoire économique, et sur tous les continents ou presque, regorge d’épisodes attestant la nocivité des marchés de capitaux libéralisés. La moindre des réponses à la crise présente, sans doute l’une des plus graves de toute l’histoire du capitalisme, ne pourrait viser en dessous de la ségrégation complète des activités de marché, dont il faut redire, et là encore attestation historique en main, qu’elles ne rendent aucun service important, ou presque, que le simple crédit bancaire ne saurait rendre (« et la Bourse des actions ! », s’écrient alors éperdus les amis de la finance de marché, même sous le fordisme il y en avait une — c’est qu’il n’était pas allé assez loin et ne s’était pas aperçu qu’on peut carrément s’en passer [12]).
Par une indulgence en fait coupable, on pourrait tolérer qu’il demeure des activités de marché. Mais sous l’interdiction formelle faite aux banques de dépôt d’avoir le moindre contact avec ceux qui s’y livrent. Comme on pouvait s’y attendre, la première protestation apeurée (bien à tort) des banquiers français est allée au rappel de ce que le modèle de banque n’était pour rien dans cette affaire, qu’on avait vu de pures banques de marché, comme Bear et Lehman, aller au tapis, et que les banques universelles « à la française » s’était très honorablement comportées. Sauf vaine discussion sur les points d’honneur de la profession bancaire, et le « comportement » réel des banques françaises à l’épreuve de la crise, on appréciera davantage le culot de ces messieurs. Qui sont touchants de candeur de nous enseigner que, oui, être assis sur le tas des dépôts aide bien à amortir les gamelles ! On en est donc arrivé au point où il faut leurrappeler que l’argent du public n’a pas exactement pour vocation de les aider à tenir plus confortablement le choc de leurs pertes spéculatives — on mesurera d’ailleurs l’arrogance innocente de la finance qui, pour se défendre, ne voit même plus le mal à consentir l’aveu qu’elle compte exposer les dépôts aux risques de ses turpitudes spéculatives, et qu’elle est même bien contente de les avoir sous la main !
Même le banking split complet [13], en lieu et place de la filialisation et des conceptions passablement Titanic que Karine Berger se fait de « l’étanchéité », ne suffirait pas à apporter une réponse satisfaisante. Il faut couper absolument toute connexion entre les institutions de dépôts et les banques de marché, non seulement, évidemment, tout lien capitalistique du type holding-filiale, mais tout lien de crédit ou de contrepartie avec n’importe quel acteur spéculatif, puisque c’est aussi par ce genre de canaux que les dépôts finissent par se trouver exposés. Ceci signifie qu’une banque commerciale ne pourra en aucun cas être impliquée dans une relation de crédit avec une banque de marché — en tous cas du côté créancier. Laquelle clause suppose alors d’instituer deux marchés interbancaires séparés. Voilà ce qui suit de prendre au sérieux l’idée deséparation bancaire : séparation dans tous les domaines ! Séparation des institutions bancaires elles-mêmes ; séparation de leurs conditions réglementaires (ratios de capital, leviérisation, etc.) ; séparation des marchés interbancaires ; et comme on l’avait proposé il y a quelque temps déjà [14], séparation des taux d’intérêts de la banque centrale pour les refinancements respectifs des banques commerciales et des banques de marché [15].
Si le socialisme de gouvernement n’était pas complètement colonisé de l’intérieur par la finance, s’il lui restait quelques audaces et s’il avait pris un tant soit peu la mesure des désastres que la finance de marché a infligés au corps social, ça n’est pas cette indigente loi de « séparation » qu’il lui imposerait. Mais une loi d’apartheid.





 Ce sera donc du gâteau pour les historiens d’ici quelques décennies de se livrer à l’analyse comparée des réactions respectives à la crise financière des années trente et à celle de 2007, et l’on saura à quoi s’en tenir quant à la tenue des élites des deux époques, leur degré de compromission avec les forces de la finance et de servilité vis-à-vis des puissances d’argent. « La solution du rapport Liikanen est certes trop radicale… », déclare sur le ton de l’évidence Karine Berger, à propos d’une de ses dispositions (relative au traitement des opérations dites de « tenue de marché »). « Certes ». Fouetter les banquiers avec le plumeau du rapport de la Commission européenne, c’est en effet d’une insoutenable violence. Ne connaissant pas à Karine Berger de lien financier crasseux avec les institutions bancaires — à la manière de certains économistes en Cercle — nous savons donc maintenant qu’on peut être vendu(e) à la finance sans en toucher le moindre sou ! Ce qui est peut-être pire encore… Un article de Benjamin Masse-Stamberger sur l’art et la manière du lobbying bancaire de vider un projet de régulation de toute substance [
Ce sera donc du gâteau pour les historiens d’ici quelques décennies de se livrer à l’analyse comparée des réactions respectives à la crise financière des années trente et à celle de 2007, et l’on saura à quoi s’en tenir quant à la tenue des élites des deux époques, leur degré de compromission avec les forces de la finance et de servilité vis-à-vis des puissances d’argent. « La solution du rapport Liikanen est certes trop radicale… », déclare sur le ton de l’évidence Karine Berger, à propos d’une de ses dispositions (relative au traitement des opérations dites de « tenue de marché »). « Certes ». Fouetter les banquiers avec le plumeau du rapport de la Commission européenne, c’est en effet d’une insoutenable violence. Ne connaissant pas à Karine Berger de lien financier crasseux avec les institutions bancaires — à la manière de certains économistes en Cercle — nous savons donc maintenant qu’on peut être vendu(e) à la finance sans en toucher le moindre sou ! Ce qui est peut-être pire encore… Un article de Benjamin Masse-Stamberger sur l’art et la manière du lobbying bancaire de vider un projet de régulation de toute substance [